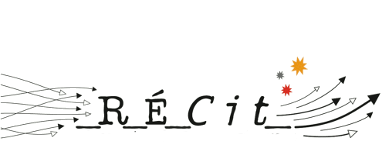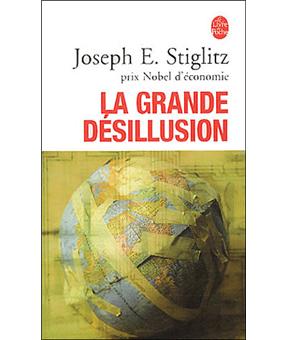– Il est rare d’avoir une critique aussi décapante et argumentée du FMI.
Celle-ci a d’autant plus de force qu’elle vient pratiquement de l’intérieur, d’un auteur qui a l’autorité de sa double casquette, celle d’un universitaire prix Nobel d’Economie et celle d’un praticien (conseiller de Clinton de 1993 à 1997 et Vice-Président de la Banque Mondiale de 1997 à 2000).
A partir d’analyses concrètes, notamment de la crise asiatique, des transitions russes et est-européennes ou de situations africaines (Ethiopie), il montre les échecs du FMI et leurs conséquences dramatiques, à la fois économiques mais aussi sociales et politiques. Ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui n’ont pas suivi ses recettes, ont préféré une approche gradualiste (Pologne), ont contrôlé les mouvements de capitaux (Chili), ont développé leur propre voie avec un rôle important de l’Etat (Malaisie ?).
Le contraste est saisissant entre la Chine qui, sans le FMI, a suivi une politique nationale non « orthodoxe » et a obtenu une croissance à deux chiffres et la Russie où « le PIB de 2000 représente moins des deux tiers de son niveau de 1989 », malgré les conseils et les milliards du FMI. Sans oublier l’Argentine, autre élève modèle.
Les mesures préconisées par le FMI, quand elles ont été suivies, ont aggravé les situations. Le FMI fait plutôt partie du problème que des solutions.
– Comment expliquer cette faillite ?
Si, pour STIGLITZ, le FMI sert objectivement les intérêts de la « communauté financière internationale », et particulièrement des Etats-Unis, il ne faut pas interpréter sa politique par une théorie du complot. Les dirigeants du FMI sont, avant tout, convaincus qu’ils ont raison, que certes les mesures préconisées sont douloureuses, mais que cette souffrance temporaire est nécessaire (DG un inconscient chrétien ?) pour rétablir les grands équilibres. D’où la nécessité de mener d’abord une critique intellectuelle.
STIGLITZ montre que le FMI fait de la mauvaise économie parce qu’il est animé par une idéologie et non par une analyse scientifique. Cette idéologie est « le fanatisme du marché », c’est-à-dire une croyance qui n’a pas besoin d’être démontrée, que les marché fonctionnent correctement et trouvent toujours les meilleures solutions, pour peu qu’on les « libère » de leurs entraves.
D’où, toujours les mêmes remèdes : privatisation, libéralisation, incitation à l’investissement privé étranger, Etat minimum, quel que soit le type de pays ou le type de problème (STIGLITZ montre que le FMI impose en Asie et en Afrique des solutions mises au point pour l’Amérique latine, à la période de l’hyper inflation).
STIGLITZ propose un retour à une démarche plus scientifique, partant de la diversité des situations concrètes et de la nécessité de débats entre plusieurs solutions alternatives. « Il n’y a jamais de solution unique ». Il rappelle au passage quelques vérités élémentaires :
· L’économie n’est jamais complètement autonome et entretient des liens complexes avec le politique, le social et le culturel : « pour qu’une économie fonctionne la cohésion sociale compte ».
· Les marchés réels sont toujours imparfaits (c’est la spécialité académique de STIGLITZ), notamment au niveau de la concurrence et de « l’information imparfaite ».
· Pour qu’ils fonctionnent, il faut mettre en place des « infrastructures institutionnelles » (les réglementations financières, la justice pour faire respecter les contrats).
· Le rôle de l’Etat reste primordial. Il est lui-même imparfait, mais son intervention est nécessaire pour limiter les imperfections du marché et créer les institutions indispensables à son fonctionnement.
Le FMI, créé au départ sous l’impulsion de Keynes, pour corriger les imperfections du marché international, suite aux analyses sur la grande dépression, a abandonné son rôle et s’est transformé en chantre « fanatique » du libéralisme.
Même si cela n’est pas toujours explicité dans le livre, l’échec du FMI peut s’expliquer par une liaison étroite entre son idéologie, les intérêts qu’il sert objectivement (« on trouve des milliards pour tirer d’affaire les banques, mais pas les quelques sous nécessaires pour soutenir les prix alimentaires à l’intention de ceux que les plans du FMI ont privés d’emploi »), et son mode d’organisation : domination des pays riches du Nord et notamment des Etats-Unis, représentation par des fonctionnaires des Ministères des Finances ou d’anciens banquiers habitués à la non transparence, à la culture du secret, à la non obligation de rendre des comptes à une instance démocratique, ayant un sentiment d’infaillibilité, non informé des recherches économiques récentes et appliquant donc des modèles dépassés ?
– A partir de ce noir tableau, STIGLITZ fait dans un dernier chapitre (pages 279 à 324) un certain nombre de propositions , intéressantes mais pas très originales, pour aller « vers une mondialisation à visage humain ».
Car, « aujourd’hui, la mondialisation ça ne marche pas. Ca ne marche pas pour les pauvres du monde. Ca ne marche pas pour l’environnement. Ca ne marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale. La transition du communisme à l’économie de marché a été si mal gérée que, partout sauf en Chine, au Vietnam et dans quelques rares pays d’Europe de l’Est, la pauvreté est montée en flèche et les revenus se sont effondrés ».
Sans se faire trop d’illusions sur leur faisabilité immédiate et sur les nombreuses réticences qu’elles vont susciter, il suggère des mesures pour réformer le FMI, la Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Aide Publique au Développement et lutter contre la « biopiraterie ». « Si la mondialisation reste gérée comme par le passé, elle continuera de répandre la pauvreté et l’instabilité ». « Il faut changer les institutions et changer l’état d’esprit ».
Il prône, notamment, un rééquilibrage des pouvoirs en faveur des pays du Sud (dont l’entrée de la Chine à l’OMC peut être un des prémices) une autonomie plus grande de chaque Etat qui doit tenir lui-même le gouvernail , une conduite plus responsable des Etats du Nord qui doivent chercher à ne pas nuire, accepter de réformer les institutions internationales et appliquer à eux-mêmes leurs propres discours (notamment au niveau des protections).
– En fait, STIGLITZ reste dans la ligne d’un universitaire réformiste post-Keynésien, cherchant de nouvelles articulations Etat / Marché au niveau de chaque pays et une architecture économique mondiale moins déséquilibrée.
Et c’est déjà beaucoup, tout le monde pourra trouver dans son livre de bons arguments critiques contre la mondialisation actuelle et surtout contre le FMI et le Trésor américain. « S’il y a un mécontentement contre la mondialisation, c’est parce que, manifestement, elle a mis non seulement l’économie au-dessus de tout mais aussi une vision particulière de l’économie -le fanatisme du marché- au-dessus de toutes les autres ».
Mais il reste peu critique vis-à-vis de la Banque Mondiale sauf quand elle sert le FMI ; cela fera peut-être l’objet d’un autre livre ? Il semble croire possible et efficace sa croisade envers la lutte contre la pauvreté, avec ses cadres stratégiques, définis dans chaque pays par des Etats ayant établi des dialogues démocratiques avec leurs sociétés civiles. Ceci semble bien loin des réalités observées.
Peut-être ce qui manque le plus dans ce livre ce sont des analyses politiques plus réalistes. Tout en soulignant les aspects positifs des mouvements anti-OMC ou Jubilée 2000 pour l’annulation de la dette, et en constatant que des milliards de personnes (« les pauvres ») n’ont pas voix au chapitre quand il s’agit de décider , STIGLITZ croît sans doute trop à un « Etat de droit » contrôlé par sa « société civile ». Tout obnubilé par son articulation Etat / Marché, il semble oublier le troisième volet du tryptique, c’est-à-dire une démocratie rénovée, aux échelons locaux, nationaux et mondiaux. Car sans mouvements sociaux qui imposera la nécessité des réformes ?