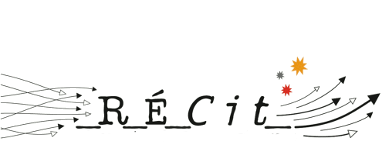Un mythe s’impose aujourd’hui : l’Entreprise serait désormais la source des valeurs, non seulement économiques mais morales, celles qui nous permettent de vivre ensemble. La question que je voudrais poser est la suivante : un discours de plus en plus dense, massif, pesant nous oblige à penser que l’Entreprise est l’entité la mieux à même aujourd’hui de répondre à la crise de l’éducation de notre époque. Il conviendrait donc que les administrateurs, les responsables, les enseignants, les conseillers d’orientation, prennent les dispositions nécessaires pour introduire à tout niveau « le point de vue de l’Entreprise ». Quels sont les enjeux et les conséquences de cette injonction qui pèse désormais sur tous les agents de l’éducation ?
Le nouveau modèle éducatif de l’Entreprise
Laurence Parisot, lors de son élection à la tête du MEDEF le 5 juillet 2005, a fait une déclaration extrêmement intéressante qui est passée quasi inaperçue mais qui mérite pourtant la plus grande attention :
« Je ne cesse de le répéter depuis deux ans : nous les Entrepreneurs, nous pouvons être à ce siècle encore tout jeune, ce que les instituteurs ont été à notre IIIè République. L’école était chargée de former le citoyen, c’est à l’entreprise aujourd’hui de lui apprendre le nouveau monde. Les instituteurs étaient les messagers de l’universel républicain, les entrepreneurs sont aujourd’hui les porteurs de la diversité de la mondialisation. Les instituteurs détenaient la clé de la promotion populaire. Nous, les entrepreneurs, nous sommes les moteurs de l’ascension sociale. Comme eux, nous devons contribuer à rendre le monde lisible. »
Cette citation, très parlante, et sans doute un peu auto-caricaturale, résume un projet global, un nouveau modèle éducatif que j’appelle le modèle entrepreneurial. Laurence Parisot a donné un but à l’organisation patronale : « faire aimer aux Français l’économie de marché ». Ce projet global, nous ne pourrons pas en explorer toutes les dimensions sectorielles, locales, tous les aspects et applications. Il renvoie à un changement général des valeurs culturelles, qui n’a pas encore été assez pris en compte, sauf par des travaux pionniers comme ceux de Jean-Pierre Le Goff, dans un livre fondamental, Le mythe de l’entreprise qui date de 1992[1][1].
Ce projet éducatif a trois aspects : la prédominance de la logique de « l’employabilité » sur les apprentissages culturels et intellectuels, traduction locale de l’emprise de l’économisme qui règne dans notre société. C’est sans doute cet aspect que les personnels chargés de l’orientation rencontrent le plus immédiatement dans leur pratique. Mais il n’est pas nouveau, même s’il est plus prégnant qu’avant, et il n’est pas seul.
La vraie nouveauté tient à ce que cet aspect « économiste » est désormais relayé et renforcé par des prétentions nouvelles qui touchent les contenus de l’enseignement et la formation de la personnalité des élèves. C’est par là que l’Entreprise dessine un modèle éducatif global que je voudrais présenter ici.
Les systèmes éducatifs modernes ont plusieurs fonctions. Ce sont des systèmes « multifonctionnels ». Pour faire simple, on peut distinguer trois grandes fonctions :
![]() une fonction de formation intellectuelle
une fonction de formation intellectuelle
![]() une fonction de formation morale et politique
une fonction de formation morale et politique
![]() une fonction de formation professionnelle
une fonction de formation professionnelle
Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, il faudrait ajouter une fonction scientifique de recherche.
Les fondateurs de l’école républicaine en France retenait un triptyque : former le travailleur, le citoyen, l’homme. On trouverait ailleurs et selon d’autres codes la même idée d’une telle pluralité fonctionnelle. Un modèle éducatif doit être capable d’intégrer de façon cohérente ces trois (ou quatre) dimensions,non sans en privilégier l’une ou l’autre selon les niveaux. L’école publique, nationale, c’est-à-dire l’école correspondant à l’État-nation a incontestablement dessiné l’un de ces modèles historiques.
Mon questionnement et mon hypothèse consistent à se demander si, étant donné le contexte général d’affaiblissement des États-nations et leur perte de légitimité dans le travail de représentation et d’intégration des sociétés, l’Entreprise n’est pas en position aujourd’hui de proposer, voire d’imposer avec l’aide des gouvernements un nouveau modèle éducatif dans les sociétés capitalistes à l’âge de la mondialisation.
J’examinerai successivement les trois aspects de ce nouveau modèle éducatif.
Une professionnalisation de l’éducation grâce à l’Entreprise
Le premier aspect, bien sûr, c’est la dimension professionnelle de la formation scolaire, dont l’Entreprise se voudrait sinon le seul, du moins le meilleur agent.
La première caractéristique de la période que nous traversons est d’accentuer la dominance de la fonction « professionnelle » sur les autres, au nom de la demande sociale des ménages et de la demande économique de l’appareil productif. La « professionnalisation » des cursus et des diplômes est la tendance lourde des systèmes éducatifs.
C’est dans ce contexte, dans la construction duquel les entreprises jouent évidemment un rôle, que les entreprises voient leur propre fonction formatrice croître non seulement dans le cadre de la définition des profils professionnels ( fameux « référentiels »), mais aussi dans la formation elle-même, par différents biais, en particulier l’essor de l’alternance, de l’apprentissage, des stages de professionnalisation, lesquels posent évidemment à chaque fois des problèmes particuliers que nous n’avons pas le temps de traiter ici.
Ce rôle accru, sinon central de l’Entreprise, dans la formation s’est progressivement imposé à partir d’un travail symbolique et intellectuel mené par toute une série de forces politiques, économiques, syndicales, agissant en faveur du « rapprochement entreprise-école », particulièrement dans les années 80. Pour ne citer que lui, le Haut Comité Education-Économie, créé au milieu des années 80, a joué un rôle considérable de relais des ambitions patronales et de construction d’un consensus relatif autour de l’intervention croissante et polymorphe des entreprises dans la définition et la mise en œuvre de la formation professionnelle. La problématique qui sous-tendait ce travail de rapprochement voulait qu’il y ait un intérêt mutuel, une harmonie même, entre « offre » et « demande » de formation, la cause du chômage des jeunes relevant, dans cette interprétation, d’une inadéquation des formations scolaires aux emplois proposés.
La conclusion qui s’est imposée, au bout du compte, et en dépit de réticences ou de résistances du côté des enseignants et de leurs organisations, depuis une bonne vingtaine d’années, consiste à dire que, puisque l’école a pour objectif premier ou principal les débouchés professionnels, l’Entreprise est la mieux placée pour apporter dans la formation scolaire les éléments de savoir et de savoir-faire, les valeurs, les qualités et surtout, la définition voire la transmission des « compétences » réclamées pour chaque type d’emploi. Le modèle éducatif de l’entreprise a donc pour premier principe de permettre dès l’école, par la mise en oeuvre de formes diverses de coopération ou de « partenariat », une adaptation de la main d’œuvre et une différenciation plus fine des profils et des compétences à acquérir pour les faire mieux correspondre aux postes professionnels. La stratégie a consisté à décalquer la formation sur la structure de la division technique, fonctionnelle du travail dans l’entreprise.
Cette prétention n’est pas complètement nouvelle, et elle est évidemment inégale selon la nature des formations, leur « public », leur plus ou moins grande proximité avec le marché du travail. Mais un seuil qualitatif a été franchi par l’imposition d’un discours institutionnel qui tend à « finaliser » donc à justifier (ou à dévaluer) les formations selon le rapport qu’elles entretiennent avec l’objectif du débouché professionnel. Plus encore, l’imposition de catégories universelles comme celles de « compétence » a permis l’établissement d’un mode de penser homogène dans le monde de la production et dans le monde de l’éducation, une révolution symbolique qui a pour effet une réduction de l’autonomie du champ éducatif vis-à-vis du champ économique.
Un enseignement valorisant le rôle de l’Entreprise et l’économie de marché
Le deuxième volet du modèle éducatif entrepreneurial est plus nouveau et, à certains égards, plus audacieux. Il concerne le contenu même de l’enseignement, et affecte donc la fonction de formation intellectuelle dévolue à l’école. Ce contenu, selon le modèle entrepreneurial, devrait d’abord faire une place beaucoup plus grande à l’entreprise et à l’économie de marché et donner ensuite de ces deux objets d’étude une vision beaucoup plus positive que cela n’est fait à l’heure actuelle. Toutes les disciplines ne sont pas visées pareillement par la critique. Ce sont les sciences économiques et sociales qui sont le plus régulièrement dénoncées, dans la presse économique en particulier, faisant de cette discipline un « bouc émissaire », ce qui n’est pas sans faire penser à la manière dont autrefois la presse cléricale dénonçait un enseignement de philosophie matérialiste et athée, responsable de la dégradation des mœurs de la jeunesse. Les Échos, l’Expansion, Capital, Le Figaro mais aussi Le Monde, font état de façon répétée d’un enseignement anti-libéral, keynésien, voire altermondialiste quand ce n’est pas tout simplement marxiste.
Un éditorialiste des Echos écrivait récemment, dans un style très éloquent quant à sa façon de raisonner :« (…) on ne peut s’empêcher de penser que la façon dont l’économie et le social sont abordés n’est pas pour rien dans le rejet, par une large partie de l’opinion, de l’économie de marché et du libéralisme. Une attitude unique dans les grands pays industrialisés. »
Les critiques les moins fondées et les contre-vérités les plus flagrantes sont proférées dans des propos à l’emporte-pièce. Luc Ferry, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, était parfaitement explicite dans un entretien donné à l’Expansion au mois de mai dernier. Au journaliste qui lui demandait sous la forme de l’évidence naïve et innocente : « Est-il possible de réconcilier l’école et l’entreprise quand une grande partie de l’enseignement est hostile à l’économie de marché ? », l’ancien ministre philosophe répondait : « Les programmes d’économie me semblent, en effet, hors du monde, bourrés d’idéologie. Je n’ai pas réussi à les changer autant que je l’aurais voulu, mais j’y ai quand même introduit des notions aussi extravagantes qu’« entreprise » ou « marché », qui étaient absentes des textes avant mon arrivée »[2][2]. Les professeurs de SES n’ont guère eu de mal de montrer que ces objets d’étude sont présents dans les programmes et les manuels depuis l’origine de leur discipline. Mais aucun journal ne s’est fait l’écho de cette rectification[3][3].
Un certain nombre de groupements, de cercles ou de clubs liés au monde des entreprises sont, sinon à l’origine, du moins très impliqués dans cette « chasse aux sorcières » pédagogico-idéologique à laquelle on assiste par médias interposés. L’Institut de l’Entreprise (IDEP) [4][4] a fait de la réforme de l’enseignement de l’économie son cheval de bataille, suivi en cela par l’Institut Montaigne (dirigé par Claude Bébéar, le patron d’AXA) avec un relais efficace de la part de l’inspection générale de SES et du ministère de l’Éducation.
L’un des faits les plus spectaculaires a été la prise en charge par l’Institut de l’Entreprise de la formation en longue durée (deux mois de « stage en immersion ») des enseignants de cette discipline, afin de leur faire découvrir les réalités, les contraintes et les succès des grandes entreprises françaises[5][5]. Cette nouveauté, qui n’est, d’après ses promoteurs, qu’un commencement, est déjà en elle-même exemplaire du rôle que l’Entreprise entend jouer dans la définition des programmes, dans la formation des enseignants, dans la rédaction des manuels (l’Institut de l’entreprise a d’ores et déjà mis en ligne un manuel de terminales de SES sur son site , avec un lien en bonne place sur le site du ministère).
Intéressons nous à l’Institut de l’entreprise ( on devrait naturellement faire la même enquête sur l’Institut Montaigne).L’institut de l’Entreprise présidé par Michel Pébereau, qui est par ailleurs président de BNP Paribas, est un organisme puissant, ne serait-ce qua par le poids que représentent les sociétés qui en sont membres. Sa stratégie est à la fois celle d’un think tank et celle d’un lobby. Son but consiste à « améliorer l’environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises »[6][6]. La clé de cette stratégie tient dans l’idée que les facteurs mentaux, culturels, idéologiques sont fondamentaux pour améliorer le cadre légal, juridique, politique, social des entreprises. L’éducation est donc un « cœur de cible », si l’on peut dire.. D’où la volonté de convertir les enseignants d’économie tout particulièrement aux vertus de l’entreprise et de l’économie de marché, afin que leurs élèves et leurs collègues puissent eux-mêmes bénéficier de cette révélation[7][7].
Cette stratégie pédagogique ne s’arrête pas aux frontières de l’éducation nationale. Les journalistes, les responsables politiques et associatifs sont également sollicités. On peut même dire que l’idée a fait son chemin pour devenir une politique gouvernementale à part entière. On pouvait ainsi lire dans Le Monde du 2 septembre 2006 un article intitulé « M. Breton veut modifier la culture économique en France ». On y apprenait l’installation le 4 septembre d’un Conseil pour la diffusion de la culture économique (Codice), dont Thierry Breton avait confié dès le début du mois de juillet la présidence à Claude Perdriel, patron du Nouvel Observateur et de Challenges. Son but était ainsi défini par Le Monde : « Le CODICE devra aider Bercy à faire progresser la culture économique dans un pays où elle est sous-développée et où l’économie de marché fait encore débat. Pour ce faire, son président disposera à Bercy d’un site Web, d’un budget et d’une petite équipe d’une quinzaine de personnes, parmi lesquelles figure le délégué général de l’institut de l’entreprise, Jean-Pierre Boisivon ». La présentation du Conseil s’appuyait sur trois enquêtes d’opinion montrant l’insuffisante information des Français et conduisant à la conclusion selon laquelle « Des attentes existent donc bien pour une véritable pédagogie de l’économie, qui permette à tout à chacun une meilleure appréhension des mécanismes économiques ».
Il n’est pas lieu de commenter la composition d’un tel organisme où l’on retrouve les représentants de l’Institut de l’Entreprise, de l’Institut Montaigne, de l’Inspection générale de SES, des universitaires, mais aussi, il est vrai, des journalistes du Nouvel Observateur et du Monde. Retenons seulement que le modèle pédagogique proposé à l’enseignement, quand il devient une affaire d’État, révèle sa nature et son importance, et par ricochet, permet de mieux comprendre la nouvelle fonction de l’Entreprise dans le dispositif éducatif. La première tâche du conseil sera de « favoriser la médiatisation de la culture économique », par voie de presse et de médias donc. C’est sans doute pourquoi c’est un patron de presse qui dirige ce Conseil. Mais l’école n’est pas oubliée : le Codice devra proposer des pistes pour rapprocher encore plus étroitement le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement.
N’est-ce pas la réinvention d’un magistère d’État sur la pensée correcte en matière économique ? Et ceci au nom du fait que les Français doivent enfin renoncer à discuter » les règles d’une économie moderne » qui fait malheureusement encore débat en France. Comme on sait, c’est la conclusion à laquelle en est venue une grande partie des élites françaises ou européennes. Ces dernières ont été très frappées par un sondage international au printemps dernier qui faisait apparaître que l’opinion publique française, parmi celles des vingt pays sondés par l’institut GlobeScan, se montrait la plus hostile à l’idée que « le système de libre entreprise et d’économie de marché est le meilleur pour l’avenir » (36% pour, 50% contre), alors que les opinions favorables étaient largement supérieures en Russie (43%), en Italie (59%), en Allemagne (65%) en Grande-Bretagne (67%), aux Etats-Unis (71%) et même en Chine (74%). Ce qui poussait Mario Monti ancien commissaire européen à la Concurrence à intituler son éditorial du 12 mai 2006 au Figaro « Oui, la France peut guérir de sa phobie antilibérale ». La France est malade, les mouvements sociaux de 1995 et de 2003, le non au référendum sur la constitution européenne, les manifestations contre le CPE, constituent autant d’épisodes de cette maladie chronique dont le symptôme est le refus des « règles de l’économie moderne ». La résistance des Français aux réformes libérales ; les mouvements sociaux qui s’y sont produits avec le soutien majoritaire de l’opinion, sont le produit de l’ignorance générale des Français et d’un mauvais enseignement de l’entreprise et de l’économie de marché à l’école. L’anti-libéralisme est interprété comme un « déficit pédagogique ». Le Codice peut être regardée comme la réponse gouvernementale au mouvement des lycées et des étudiants contre le CPE. Si l’on explique bien aux Français et surtout au jeunes les vertus du marché et particulièrement l’intérêt de libéraliser le marché du travail, alors les résistances archaïques cèderont. Telle est la philosophie éducative qui sous-tend cvette politique. Gouvernements et organisations patronales sont engagées dans une véritable conquête des esprits, dans un combat culturel contre les résistances aux lois de l’économie de marché.
L’impératif immédiat paraît politique. A l’approche des élections présidentielles, il est urgent de mettre en place des moyens « de faire de la pédagogie économique » comme dit T.Breton, visant à disqualifier « les marchands d’illusion ». Il s’agit de faire selon le ministre de l’économie « que chaque concitoyen puisse juger en connaissance de cause des projets économiques qui leur seront proposés », lors des prochaines élections a-t-il souligné lors de sa conférence de presse du 4 septembre 2006[8][8].
Cette « pédagogie de l’économie », et c’est là où cela devient plus intéressant, est présentée de façon moins superficielle et moins conjoncturelle comme une condition de la compétitivité d’une économie. Mario Monti, déjà cité explique en ce sens que « (…)dans la phase mondiale actuelle, l’accroissement de la compétitivité est un impératif pour créer des emplois productifs. A cette fin, des réformes visant à un fonctionnement plus efficace des marchés sont tenues pour nécessaires dans la plupart des pays. Partout, leur introduction se heurte à des oppositions et exige une action pédagogique importante. Si un pays a, en outre, à sa tête et dans l’opinion des réticences fondamentales de principe, la compétitivité potentielle de son économie souffre de ce que nous appellerons un « gap » culturel anticoncurrentiel ». Thierry Breton n’est pas en reste quand il inscrit sa volonté de réforme des mentalités dans un projet consistant à faire de « la France la cinquième économie mondiale en 2030 »[9][9].
C’est ainsi que l’école doit être mise au service de la puissance économique nationale. Mais la connaissance des lois de l’économie ne suffit pas. Il faut une conversion plus profonde, inscrite dans les comportements.
Réformer les attitudes et les mentalités par la culture d’entreprise
Le troisième aspect, plus neuf que les autres et encore plus étonnant, est l’introduction du thème de la « culture d’entreprise » comme problématique transversale de tous les enseignements et de tous les niveaux. C’est ici la troisième fonction, celle que l’on a désignée plus haut comme la fonction de formation morale et politique, qui est concernée. Sur ce plan, il convient de dire que la France est encore en retard par rapport à ce qui se dit et fait à l’ étranger, dans les pays où l’opinion a, si l’on en croit les sondages du moins, une vision plus favorable du marché et de l’entreprise.
Il ne s’agit plus de transmettre des connaissances économiques seules, mais de créer des aptitudes et des dispositions, regroupées dans une compétence appelée « esprit d’entreprise », et acquises à travers une « formation à l’entreprenariat ». La littérature la plus riche sur le sujet aujourd’hui est fournie par l’OCDE et de plus en plus par la Commission européenne, qui, comme on commence à le savoir, est le véritable lieu d’élaboration du nouveau modèle éducatif entrepreneurial depuis la deuxième moitié des années 90. La Commission et les autres organes de l’Europe, associés dans la définition de cette politique éducative, ont ainsi fait de « l’esprit d’entreprise » l’une des 8 « compétences clés » à faire acquérir aux jeunes Européens dans le cadre de leur scolarité[10][10]. Cette « compétence » est l’un des principaux axes de transformation des systèmes éducatifs européens, que l’on retrouve dans toutes les réformes ou propositions de réforme de ces trois ou quatre dernières années[11][11].
La définition de cette compétence renvoie à un type de conduite valorisé, à un modèle d’excellence qu’il faut viser. En ce sens, elle appartient à un registre strictement normatif. On lit ainsi dans les documents européens qu’ « un esprit d’entreprise se caractérise par une disposition à prendre des initiatives, à anticiper, à être indépendant et novateur dans la vie privée et en société, autant qu’au travail. Il implique aussi motivation et détermination au travail et/ou dans la réalisation d’objectifs, qu’il s’agisse d’objectifs personnels ou de buts collectifs. »[12][12] Dans d’autres définitions, on trouve l’idée selon laquelle « l’esprit d’entreprise » consiste avant tout dans « la détermination et l’aptitude d’un individu , isolé ou au sein d’une organisation, à identifier une opportunité et à la saisir pour produire une nouvelle valeur ou le succès économique »[13][13]. Il ne s’agit pas seulement, comme on pourrait le penser, de fixer au plus grand nombre l’objectif social et professionnel de devenir un jour chef d’entreprise, mais plutôt de proposer une nouvelle norme de conduite sociale et professionnelle aux 95 % de salariés qui composent la population active afin qu’ils travaillent de façon efficace, qu’ils innovent, qu’ils prennent des initiatives à la manière d’un entrepreneur performant.
Les connaissances ne sont pas oubliées, elles sont intégrées à cette compétence comportementale, subordonnées donc au registre normatif évoqué plus haut[14][14]. On dépasse avec cette notion le seul cadre de l’enseignement « positif » de l’entreprise et de l’économie de marché. Cette compétence doit être développée dans toutes les disciplines sous la forme d’une pédagogie favorisant l’ouverture sur l’extérieur et l’initiative des élèves. L’intégration de cette « compétence » dans la logique dite de transversalité qui est au principe de la nouvelle pensée officielle en matière pédagogique le dit assez. A chaque discipline, à chaque niveau est confié le soin de décliner cette « formation à l’entreprenariat », de développer la capacité et l’envie de créer une entreprise, d’innover et d’adopter un état d’esprit favorable aux demandes des entreprises. La politique scolaire et universitaire française n’a pas échappé au mouvement. Ce fut d’abord la loi de modernisation de l’université en 1999 qui introduisit dans l’enseignement supérieur et dans la recherche des possibilités nouvelles de partenariat et d’hybridation entre entreprises privée et institutions universitaires. Ce fut ensuite l’acclimatation par étapes du programme de travail européen (Éducation et Formation 2010) qui a introduit la logique du « socle commun de compétences clés » à partir du rapport Thélot à la fin 2003 en passant par la loi Fillon de mars 2004, jusqu’aux recommandations du Haut Conseil de l’Éducation en mars 2006. Il est vrai que la prudence s’impose en France, pays si rétif à l’économisme libéral. Aussi, « l’esprit d’entreprise », a-t-il été traduit dans les recommandations par l’expression euphémisée « esprit d’initiative et d’autonomie ». Nous ne pouvons ici développer un aspect qui mériterait pourtant un examen détaillé, et qui est la manière dont aujourd’hui sont repensées les réflexions et pratiques pédagogiques dans l’optique de « l’esprit d’entreprise ».
Trois ou quatre réflexions de conclusion …
Venons en pour conclure à quelques considérations générales. Je laisse de côté si vous le voulez bien tout le travail critique précis et concret qu’il faudrait faire à propos de chacun des volets de ce projet. Ceci nous amènerait trop loin. Je me contenterai de quelques réflexions.
1-La première remarque sur laquelle je voudrais insister est la nature globale du modèle entrepreneurial, en tant qu’il affecte les trois grandes fonctions du système éducatif (une analyse plus complète nous montrerait assez facilement qu’il n’affecte pas moins la quatrième fonction, celle de création scientifique, en infléchissant sensiblement la politique de recherche).
D’un certain point de vue, les organisations patronales et les gouvernements ont certainement raison. Il nous faut changer la conception que l’on a de l’entreprise. Il ne faut plus voir en elle seulement l’unité de production de biens et de services telle qu’elle est décrite dans les manuels. L’entreprise est devenue ou pourrait devenir une institution globale, capable d’orienter la société, d’infléchir ses valeurs, d’éduquer ses membres. C’est d’ailleurs ainsi que certains courants de pensée dits néo-libéraux voient les choses quand ils imaginent une « société d’entreprises » ou encore une « société d’entrepreneurs » (Peter Drucker).
Sur le plan éducatif, l’Entreprise propose un modèle global de formation de la personne qui inclut la pratique, la connaissance, les valeurs. Ce que nous voyons se mettre à l’œuvre en France est un effet assez tardif d’une révolution qui a été observée et analysée ailleurs depuis au moins le milieu des années 90. Ce modèle éducatif n’est pensable et pratiquement possible que par un affaiblissement des Etats-nations, lesquels ont eu à un certain moment la capacité de définir un projet éducatif global, mais paraissent bien ne plus l’avoir au même degré. Désormais, l’Entreprise est une candidate très sérieuse à cette fonction globale de représentation du destin collectif, aidée en cela par les gouvernements et les organisations internationales ou intergouvernementales comme l’OCDE ou la Commission européenne. L’Église et l’État se sont relayés dans l’histoire pour exercer à travers l’institution scolaire un magistère à la fois moral, intellectuel et politique. Est-ce maintenant le tour de l’Entreprise ? On a des raisons de le penser.
2-La deuxième remarque porte sur la solidarité de cette transformation éducative en cours avec des mutations politiques, sociales, culturelles beaucoup plus vastes et profondes.
Il convient d’abord de rappeler l’action des politiques dites néo-libérales et néo-conservatrices qui jouent toutes la carte de l’entreprise comme lieu de valorisation de la discipline sociale, de l’effort, de la concurrence. Cela a d’abord concerné l’Angleterre et l’Amérique du Nord. Comme l’écrivaient au début des années 90 Paul Heelas et Paul Morris, « Aussi étrange que cela paraisse à ceux qui pensent que l’« entreprise » a seulement affaire à la création et l’acquisition, le programme de la réforme entrepreneuriale est au coeur même de la croisade morale du gouvernement »[15][15]. Les valeurs d’entreprise n’ont pas été conçues par les néo-conservateurs comme tenant seulement à la sphère économique stricto sensu mais comme partie prenante d’une réforme des esprits, des façons de percevoir le monde et sa propre vie. L’opposition de la culture d’entreprise à la culture de la dépendance ou de l’assistance est un thème majeur de ce néo-conservatisme. Il s’agit de faire en sorte que les individus se perçoivent comme des atomes seuls sur des marchés ouverts. Ce qui a des effets sur la perception que l’ on peut avoir de soi-même et des rapports aux autres, et ce qui peut même remettre en question l’idée que nous appartenons à une société. On connaît le précepte de Thatcher en 1987 : « There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families ».
On peut également attribuer à la promotion des valeurs d’entreprise un but plus limité consistant à tout « mettre en marché » ou à tout concevoir comme un marché potentiel, ce qui a pour effet de délégitimer les modes de décision publique en faisant de chacun « un consommateur actif et responsable », y compris à l’école et à l’université.
Mais la politique néo-libérale n’explique pas tout. Pas plus que l’esprit d’acquisition des classes supérieures défendant leurs privilèges, leurs stocks-options et leurs réductions d’impôts. Encore que la démarche sociologique ne peut négliger la logique des intérêts symboliques et matériels et la manière dont les groupes sociaux s’entendent à les promouvoir. Mais le problème que nous posons est plus général. L’imposition d’un tel modèle ne vient pas seul et d’un coup, elle est inséparable d’une évolution des rapports sociaux, des institutions, des subjectivités.
On peut faire l’hypothèse qu’elle est rendue possible par une modification en profondeur de ce que les sociologues appellent l’éthos, le système de valeurs qui oriente les conduites. Cet éthos contemporain enjoindrait chacun à devenir « l’entrepreneur de soi-même », à faire que le moi de chacun soit « géré » comme une entreprise. L’hypothèse pourrait permettre de comprendre en quoi et comment l’Entreprise est en train de devenir un véritable « modèle social », une source de normes et de valeurs, elle expliquerait aussi pourquoi l’Entreprise est en mesure de se poser comme nouveau modèle éducatif.
C’est bien d’ailleurs en tant que source de valeurs, voire en « fondement de la nation » ainsi que le conçoivent explicitement les responsables du monde de l’entreprise. Laurence Parisot, toujours elle proclamait ainsi cette « révolution de valeurs » lors de son élection à la tête du MEDEF le 5 juillet 2005 :
« Contre l’immobilisme du non choix et des utopies nostalgiques, nous proposons nos valeurs pour remettre la France en mouvement : l’esprit d’entreprise, le travail, le pragmatisme. Le pragmatisme, parce qu’il s’appuie sur l’expérience, la nôtre et celle des autres, parce qu’il privilégie ce qui marche sur ce qui ne marche pas.
Le travail, parce qu’il est la principale source de prospérité individuelle et collective mais aussi parce qu’il crée des liens, il jette des passerelles, il fabrique des solidarités nouvelles. L’esprit d’entreprise, parce que c’est lui qui permet de relever les défis, c’est lui qui entraîne les grandes aventures humaines, c’est lui qui nous offre l’opportunité de concrétiser nos rêves ! » Elle ne faisait là que répéter ce que son prédécesseur avait affirmé en septembre 2003 de façon encore plus nette : « l’entreprise et l’école partagent le premier rôle dans la définition des fondements de la nation »[16][16].
3-Troisième remarque de conclusion : peut-on résister à cette mutation et comment ? la réponse se trouve en partie dans la réaffirmation des valeurs scientifiques dans la recherche et dans l’enseignement lui-même. J’ai dit en commençant la portée mythologique, ou idéologique, c’est-à-dire abstraite, généralisatrice, enchanteresse de ce nouveau modèle éducatif piloté par l’Entreprise. Comment entamer une critique et développer des alternatives ?
Il y a d’abord un travail de recherche à promouvoir sur les pratiques de formation et d’information réalisées avec ou dans les entreprises. Je crois qu’il ne faut pas refuser de considérer les questions posées par le rapport entreprise-école dans la formation, mais il faut poser un regard réaliste, ou anti-mythologique, sur les modes concrets de cette formations. Il faut pour cela solliciter beaucoup plus souvent les chercheurs afin d’examiner par exemple ce que font et ce qu’apprennent les élèves et les étudiants dans les stages[17][17], ce que font et ce qu’apprennent les apprentis en entreprise. En somme faire qu’il n’y ait plus de « boîtes noires » hermétiquement closes dans la formation, et en particulier dans la formation professionnelle, qui reste mal connue.
S’il faut mieux connaître les pratiques de formation des entreprises, il faut aussi mieux enseigner le monde des entreprises dans le système éducatif. En mai 2004, les rencontres nationales sur l’enseignement de l’économie, ont ainsi réfléchi à la façon dont on pourrait intégrer les multiples dimensions de l’entreprise dans l’enseignement et elle sont souligné que cette étude devait être pluraliste, multidimensionnelle, qu’elle devait mobiliser l’ensemble des sciences sociales et pas seulement la gestion et la microéconomie. Au fond, la question qui est posée est plus générale. L’économie doit être enseignée à l’école. Dans les sondages présentés le 4 septembre par Thierry Breton, on pouvait constater que 82 % des Français interrogés répondaient que cet enseignement devait être une matière obligatoire à l’école. Mais quelle économie ? Quel enseignement de l’économie ? N’y a-t-il qu’une seule économie et une seule politique possible ? Peut-être que si les enseignants tenaient bon sur cette simple idée que l’économie, ce n’est pas une fatalité, une certaine logique totalitaire de la pensée unique serait stoppée nette.
Je mentionnerai enfin pour terminer un problème qui me paraît essentiel, mais qui réclamerait à lui seul un long développement mais que je soumets malgré tout à votre réflexion. Le modèle éducatif piloté par l’Entreprise tel que nous l’avons décrit est-il démocratique, ou plus démocratisant socialement que le modèle gouverné par des impératifs politiques ?
[1][1] Ce livre reste pertinent, bien que les analyses qu’il contient n’avaient pas encore pris en compte les développements ultérieurs. [2][2] L’Expansion, 31 mai 2006. [3][3] Il y eut des accusations encore plus graves, celles par exemple de Francis Mer, quand il était encore ministre de l’économie, dénonçant les manuels « marxistes » utilisés dans les lycées. [4][4] Créé en 1975 par François Ceyrac, patron des patrons français, et François Dalle, PDG de L’Oréal, l’IDEP est devenu au fil des ans un think tank patronal. Il réunit aujourd’hui plus de 120 adhérents, en majorité membres de grands groupes, qui génèrent un chiffre d’affaire cumulé représentant plus de 20 % du PIB marchand de la France. Le pôle de réflexion est organisé en cinq commissions : Observatoire de la dépense publique, Modernisation du droit du travail, Modernisation de la fiscalité, Benchmarking international, Entreprises dans la mondialisation. Ses efforts, depuis 2001, visent à rapprocher le monde économique de celui de l’éducation. [5][5] On remarquera que cela n’a pas encore été proposé aux enseignants en économie gestion, pourtant directement concerné par l’enseignement de l’économie et la gestion de l’entreprise. [6][6] L’Institut Montaigne a la même préoccupation consistant à « aider à la définition des politiques publiques dans le but d’améliorer l’environnement économique et social français. » [7][7] Le monde écrivait à propos de l’Institut de l’Entreprise (IDEP) : « Sous la houlette de Jean-Pierre Boisivon, économiste et agrégé en sciences de gestion, qui dirigea dix ans l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), l’Institut mène depuis six ans des actions en direction des 5 000 professeurs de sciences économiques et sociales visant à diffuser la culture de la micro-économie auprès des 200 000 lycéens des filières économiques (…)Fort de cette analyse, partagée par Michel Pébereau, président de l’Institut de l’entreprise et de BNP Paribas, qui a longtemps enseigné l’économie à l’institut d’études politiques (IEP) de Paris, le délégué général de l’IDEP et son équipe ont mis au point une base documentaire en ligne – Melchior (www.melchior.fr) -, qui propose aux professeurs données chiffrées, textes récents et études de cas.(..)Deux cents enseignants ont profité de stages d’immersion en entreprise de deux mois, alternant périodes en entreprise et travail à l’IDEP sur des thématiques d’actualité : le client, conjoncture et marché, le gouvernement d’entreprise…(…) »Notre objectif serait de toucher assez rapidement 400 à 500 enseignants, mais nous butons aujourd’hui sur l’incapacité de l’éducation nationale à remplacer les professeurs absen//ts », explique M. Boisivon, qui a lancé de grands entretiens thématiques. Les premiers, en 2003, étaient consacrés aux entreprises et à la mondialisation. (Le Monde , 2 septembre 2006).L’institut de l’entreprise est tout sauf neutre politiquement. Il suffit d’aller voir le site installé par l’ institut de l’Entreprise Debat 2007 pour constater l’orientation ouvertement libérale des propositions qui sont faites.
[8][8] Cf sur ce thème l’éditorial du Figaro : La culture économique, c’est ce qui reste à connaître, quand on ne vous a rien enseigné, par Yves de Kerdrel, Le Figaro, le 09 septembre 2006. [9][9] Breton défend l’avenir de l’économie française , Anne Rovan, Le Figaro, 07 juillet 2006 [10][10] Les 8 compétences sont 1. Communication dans la langue maternelle 2. Communication dans une langue étrangère 3. Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies 4. Culture numérique 5. Apprendre à apprendre 6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et civiques 7. Esprit d’entreprise et 8. Sensibilité culturelle. [11][11] Cf. le site www.europa.eu.int. La Commission a d’ailleurs mis sur pied un « plan d’action sur l’esprit d’entreprise » qui se propose de promouvoir l’esprit d’entreprise parmi les jeunes : « Pour assurer à tous les étudiants un accès au cours de leur formation à l’esprit d’entreprise, la Commission invite les États membres à inscrire l’éducation à l’esprit d’entreprise dans les programmes de tous les établissements d’enseignement et à proposer aux écoles les aides adéquates pour leur permettre de mettre en place des systèmes d’éducation performants et de qualité (…). » [12][12] Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (présentée par la Commission) Décembre 2005. [13][13] Livre vert de la Commission européenne, L’esprit d’entreprise en Europe, janvier 2003. [14][14] La connaissance à avoir est celle des possibilités offertes aux fins d’activités privées,professionnelles et/ou commerciales, y compris d’aspects “de plus grande ampleur” qui sont
révélateurs du contexte dans lequel des personnes vivent et travaillent, comme une
compréhension générale des mécanismes de l’économie. Il s’agit également de la
connaissance des possibilités offertes à un employeur ou à une organisation et des enjeux que ceux-ci doivent relever. Les individus devraient être au fait de la position éthique des
entreprises, et de la manière pour elles de servir d’exemple en menant une activité
commerciale honnête ou en étant une entreprise sociale.
[15][15] Cf. Paul Heelas et Paul Morris, The values of the Enterprise Culture, Routledge, 1992. [16][16] E.A Seillière, « Le nouveau positivisme », Le Monde, 9 septembre 2003. [17][17] Il a fallu la mobilisation symbolique des stagiaires dans les manifestations du CPE pour que le gouvernement prenne des mesures de régulation des stages.